Un roman engagé ? c’est peu dire. Les raisins de la colère de Steinbeck paru en 1939 conte par le menu et dans tous ses détails l’épopée – il n’y a pas d’autre mot– d’une famille, les Joad, depuis la fin de leur vie de métayers dans l’Oklahoma à leur migration vers une existence de journaliers exploités par les propriétaires des riches vergers de la Californie.

Contre le système capitalisme
Avec une écriture behavioriste, très descriptive, Steinbeck décrit et explique les mécanismes de l’exploitation des métayers d’abord et des cueilleurs ensuite. Il développe avec un luxe de détails qui sentent le travail de terrain que n’aurait pas renié un Zola, la dépossession progressive des biens, déjà réduits, dont jouissaient les métayers et le tricotage implacable des filets dans lesquels les cueilleurs sont obligés de se jeter s’il ne veulent pas que leurs enfants meurent de faim.
Cours express d’économie : comment réduire le coût du travail ? En envoyant des milliers d’annonces pour que des dizaines de milliers de journaliers se présentent alors qu’une centaine aurait suffi, et le moins-disant remporte le droit de travailler à perte et de dépenser son argent dans le magasin de l’exploitant qui surtaxe les biens vendus. Imparable.
Du réalisme humaniste
On est pourtant loin d’un roman pédagogique. Les raisins de la colère dénoncent un système, certes mais ils brossent avant tout une vaste fresque humaniste que traversent des personnages à la personnalité forte et rendue vraisemblable par leurs faiblesses et leurs difficulté à devenir des héros. Seul Tom, le fils qui sort de prison pour bonne conduite, frôle de temps en temps la stature héroïque, presque par mégarde : c’est dans la suite de l’histoire, celle que Steinbeck n’a pas écrite, qu’il serait devenu ce héros des exploités. Avec raison, Steinbeck s’est bien gardé de cet écueil. Pauvres et anonymes mais droits, voilà ce que sont les Joad tels que les présente l’auteur dans tous les actes de leur vie, qu’ils cueillent des pêches, enterrent leur grand-mère ou se baignent dans une rivière.
La justesse des portraits ne le dispute qu’à la finesse des scènes, tout en pudeur et en subtilité dans lesquelles les gestes, les regards et les silences expriment plus que les phrases les errements de cette condition d’humains qui est la leur. Une scène marque [attention spoiler] : Ma (la mère) préfère taire à tous la mort de la grand-mère au passage du poste de transfert pour éviter que la famille de soit refoulée à l’entrée de la Californie et traverse toutes les montagnes aux côtés du cadavre. Rien n’est dit, seule la couleur de son visage et quelques accès d’humeur dont s’étonne le reste de al famille révèlent que quelque chose d’anormal se passe.
Pas de misérabilisme, jamais –ils en auraient trop honte–, dans cette écriture qui rappelle seulement que rien de ce qui est humain n’est étranger à un autre humain. Même si, selon Steinbeck, c’est chez ceux qui n’ont plus rien qu’on trouve le plus d’humanité : c’est inversement proportionnel.
Une écriture poétique du monde
On parle peu en revanche de la poésie de ce roman. Elle saisit pourtant le lecteur dès les premières phrases avec une longue envolée sur la poussière et ses méfaits, et on la retrouve de loin en loin dans la description d’une tortue qui peine à suivre sa route – et qui a évoqué à ma grande surprise, l’escargot de Kew Gardens de Virginia Woolf – ou dans les couleurs des horizons.
Un regard en forme de pinceau de lumière qui éclaire le noir du réel, c’est ainsi que Steinbeck entraîne son lecteur dans cet univers qu’il recrée. Tout a l’air vrai mais tout est faux, tout est reconstitué avec art pour donner à l’absurdité de ce qui se vit ici un sens que n’aurait pas existé sans le talent de l’écrivain.
Ce regard poétique clôt le roman en une image d’une force inouïe et (sur)chargée de symboles qui rassemble tous les fils dans une seule scène audacieuse : on y retrouve aussi bien l’entraide entre pauvres humains et humains pauvres, le réalisme des conditions pitoyables des travailleurs et de leurs conséquences qu’un retournement magistral et brutal des icônes chrétiennes de la charité et de la pietà.
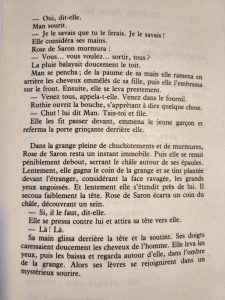
Un roman à lire aussi pour les résonances qu’il trouve aujourd’hui où d’autres migrants sont forcés de chercher ailleurs que sur leurs terres un avenir plus radieux.

