« J’ai eu une nouvelle idée pour le plan ! Mais je me demandais si on pouvait encore changer. »
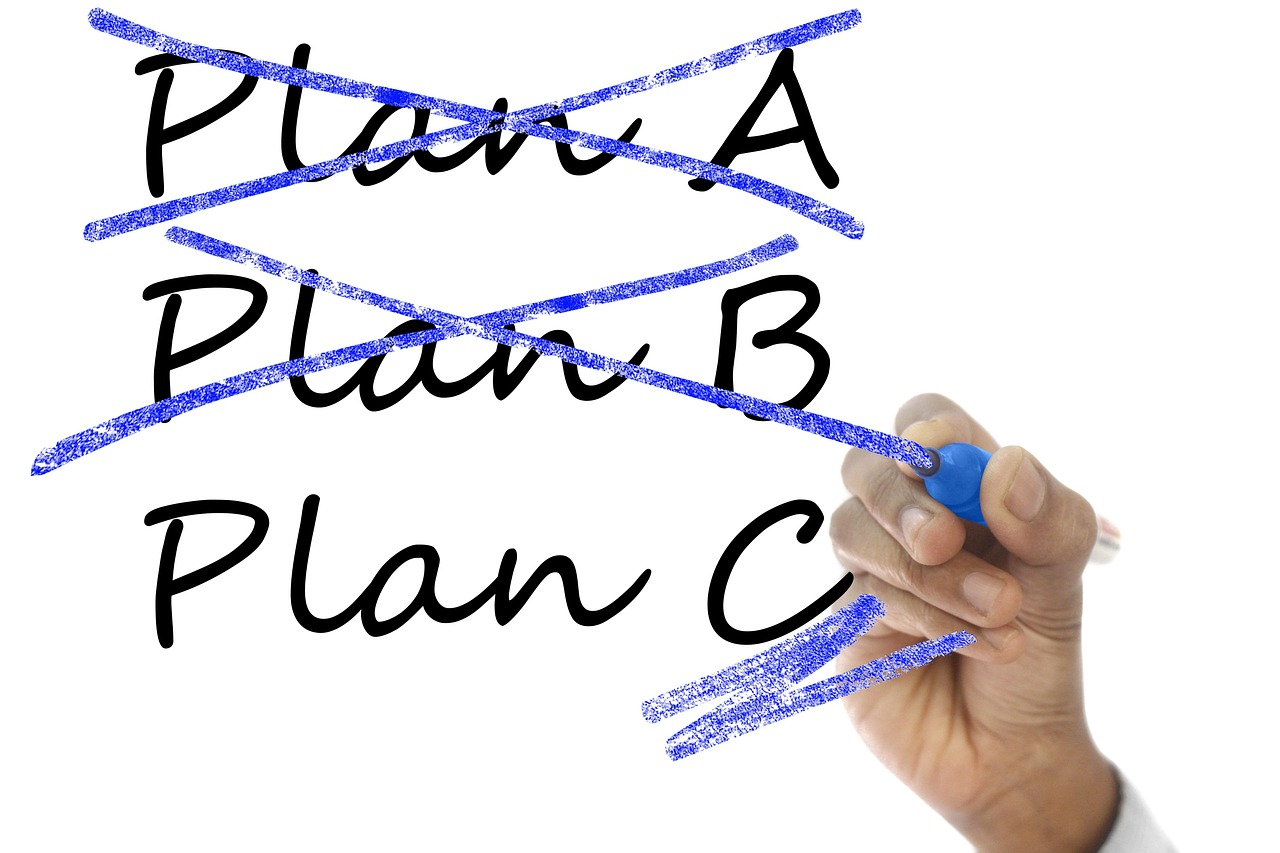
Voilà comment a débuté notre visio avec ma cliente hier après-midi : par sa manière nouvelle de présenter son histoire.
Nous avions terminé le synopsis ensemble après plusieurs discussions fructueuses, et j’allais entamer la rédaction.
À votre avis, que faire dans un cas pareil ? Pour moi, aucun doute : il faut prendre la meilleure idée.
Je lui ai d’abord demandé ce qui manquait dans le plan initial et surtout pourquoi. Son objectif n’avait pas changé mais elle voulait développer un aspect précis qui n’était qu’esquissé.
J’ai listé tous les points à ajouter.
Nous avons ensuite repris le plan initial pour voir ce qu’elle désirait en garder, j’y ai intégré les nouveautés, et enlevé ce qui ne cadrait plus.
Et enfin, je lui ai proposé différentes manières d’agencer les éléments pour correspondre à l’objectif du livre. C’est toujours le plus important : l’ordre crée le sens.
Finalement, il n’y avait pas tant de changements. L’angle choisi restait le même mais on insistait sur un aspect qu’elle sentait désormais comme fondamental.
Résultat : un plan encore plus en adéquation avec son projet. Validé !
Nous poursuivons maintenant dans cette direction.
Pour moi, il est essentiel de garder le cap tout en restant souple : plus on réfléchit à un projet, mieux on le comprend, et il n’est pas rare d’avoir une nouvelle idée en cours de projet.
Mais sans précipitation : on ne modifie pas non plus le plan tous les matins. Cette fois, c’est la bonne !
Et vous, vous changez d’avis en cours de route ?

